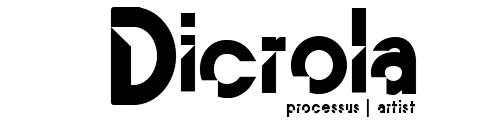Les tableaux rouilles
Lors de la seconde moitié des années quatre-vingt, Dicrola poursuit la phase matiériste de sa recherche. Ses tableaux cherchent à atteindre une synthèse entre objectalité et peinture, ou entre matiérisme et image, sans pour autant démentir les préoccupations les plus fondamentales impliquées depuis toujours dans son travail. Ils constituent en effet le pendant exact et opposé des œuvres où il expérimentait la dématérialisation de la forme. Ici, toute forme apparaît noyée dans une matière triomphante dont l’expansion tellurienne semble compromettre l’acte même de peindre. C’est non seulement la forme, mais la scansion chromatique, la marque des coups de pinceau et le plan de la toile qui sont engloutis dans un magma informel. Dicrola traverse ainsi le moment d’Antée de son œuvre, un ressourcement par cette immersion dans la matière matricielle de la peinture. Pratiquant une forme absolue du tableau-objet, il n’assemble pas des matériaux hétéroclites, mais il utilise l’accumulation chargée de pigment comme signe indexical, comme indice sursignifiant de l’œuvre comme peinture. Dans ses toiles, la picturalité est avilie à l’état de croûte, de pâte épaisse et retravaillée en fonction de la pure matérialité du tableau. Par ailleurs, surchargeant les strates de la couche picturale, Dicrola tend à retarder le séchage par auto oxydation de l’huile contenue dans les pigments. Il tient en quelque sorte ouvert le processus d’accomplissement de l’œuvre, refusant ainsi sa véritable clôture. Ce choix annonce l’un des développements de sa recherche à venir, en particulier les «tableaux rouillés».
La phase de la peinture matiériste se termine au début de l’année 1988 par une expérience assez étonnante. Il expose alors une série de tableaux, réunis sous le titre «Urbi mon amour», à la galerie Ariadne de Vienne. Il y opère une récupération citationniste de l’iconographie de De Chirico, introduisant un nouveau thème, celui de la ville industrielle appréhendée par les grandes cheminées d’usines des faubourgs ouvriers tels qu’ils se profilaient à la fin du XIXe siècle. Pressentant le déclin du monde lié à la production industrielle, il veut à la fois rendre hommage à la civilisation du charbon et du fer qui a marqué la modernité du XXe siècle et dénoncer les dégâts qu’elle a causés en termes de qualité de vie.
Le titre est évidemment une paraphrase du célèbre film d’Alain Resnais. En effet, comme dans Hiroshima mon amour, le thème est ici celui de la mémoire qui décante la fin d’une époque. Dicrola peint des toiles intitulées Wien mon amour, Énergies verticales, Urbi mon amour, Vestiges de la mémoire, Archéologie d’une ville, qui témoignent de sa volonté de rendre hommage au passé de la culture urbaine et d’évoquer l’épopée qui a vu naître et s’affirmer la ville industrielle. Ce sont des tableaux où la cheminée est élevée au rang d’une métaphore du travail des hommes et du devenir de la ville tandis qu’une sorte de brume brunâtre engloutit l’image, restituant par sa tonalité l’atmosphère d’une époque. Dicrola réalise ainsi plusieurs œuvres matiéristes où des cheminées rouges vermillon, se terminant par un panache d’un noir très profond, se détachent sur un fond brun rose assez tourmenté. Il recourt, pour l’une des rares fois dans son œuvre, à un matériau étranger à la peinture: du café lyophilisé. Le procédé qu’il expérimente consiste à recouvrir la toile de poudre de Nescafé avant de commencer à peindre, adoptant alors un temps d’exécution assez rapide. Le travail terminé, il réchauffe la toile, provoquant une réaction de suintement de la colle arabique contenue dans la poudre de Nescafé qui remonte à la surface, craquelant la peinture et brunissant les teintes. Ce processus chimique produit des effets de matières et de couleurs des plus élégants qui donnent une unité tonale à la peinture, lui assurant une tactilité veloutée et des teintes très chaudes.
Il travaille en même temps le contenu compositionnel de l’image, comme dans l’œuvre sur papier Usines industrielles, qu’il expose cette même année à la galerie L’Aire du Verseau. Il s’agit d’un tableau sur lequel il a peint dans la pâte, au centre, une grande cheminée d’usine alors que celles qui l’entourent, plus petites, sont dessinées dans la masse avec la pointe du manche du pinceau. L’œuvre se compose d’empâtements bleus, jaune, rouge vermillon, tous utilisant comme liant la poudre brune du Nescafé qui se mêle à l’ensemble de ces couleurs. Dicrola y traite la verticalité en opposition à l’horizontalité - et vice-versa - suivant une approche géométrique.
Cette expérience singulière, ouvrant l’hypothèse d’une promiscuité ou d’une collusion, se referme aussitôt. Mais il s’agit d’une expérience très féconde lui permettant de passer à une autre phase de son travail. Sa remise en cause de la peinture devient alors plus radicale, parce qu’il évolue de la toile à la tôle, élaborant ce qu’il appelle ses « tableaux rouillés ». Il s’agit d’œuvres littéralement peintes par la rouille, en ce sens que Dicrola exploite l’altération et l’usure des surfaces oxydées. Il utilise en effet comme support des panneaux industriels de tôle revêtue de peinture. Il s’agit de plaques de métal électrozinguées ou thermolaquées, ou encore peintes selon la technique de placage par électrolyse qui les recouvre d’une mince couche uniforme de peinture brillante. Il fait alors attaquer la surface métallique par un acide qu’il utilise à l’égal d’une encre de dessin. Sa composition se grave dans le métal corrodé par l’acide, lequel engendre une rouille qui ne peut que s’étendre sans fin puisque Dicrola se refuse à appliquer un quelconque stabilisateur. Autrement dit, il revient à son travail sur la destruction de l’œuvre par l’action du temps. Simplement, au lieu de mettre en scène un objet de glace qui fond rapidement, il propose une image d’oxydation du fer qui se dissout avec lenteur.
Pourtant, au regard de l’infini, cet écart temporel entre la glace qui fond à vue d’œil et la rouille qui ronge au ralenti est infime. Avec la glace, Dicrola travaillait en sculpteur. Avec l’acide, il travaille en peintre. Mais le propos est le même. La défiguration qui était à l’œuvre avec la surcharge de pigment reprend sous une autre forme car le passage de la toile à la tôle ne modifie en rien son approche de la matière comme entité à part entière. Il s’approprie la rouille comme trace d’un processus, comme signe du temps et de la mémoire, l’envisageant ainsi comme langage esthétique aux diverses possibilités expressives. Il mise également sur le hasard, faisant totalement confiance au déterminisme de la matière qui va être à l’origine, en toute autonomie, des couleurs et des formes de l’oxydation. Il s’empare en même temps des thèmes et des images de De Chirico, le peintre métaphysicien qui a exalté la cheminée en fonction d’une mythologie des temps modernes. Ayant renoncé à la peinture, Dicrola cesse d’utiliser le pinceau. Il aborde des matériaux propres au monde industriel et traite son motif à l’acide, travaillant avec un gant de fer, des fioles et des racloirs afin de provoquer l’agression du métal et la corrosion de la surface peinte qui produit les taches brunes correspondant à l’apparition de la rouille. Son intervention est réduite à la plus simple des manipulations puisqu’elle se limite à un grossier décapage, sans aucun apport de peinture. Comme support, il utilise généralement un panneau de tôle aux bords repliés, d’un gris classique, parfois d’un noir ou d’un bleu saturé, à l’apparence solide et fonctionnelle propre aux matériaux industriels. Le fond brillant y apparaît à l’égal du ciel dans une peinture classique, ce qui est l’équivalent du vide.
La rouille vient lacérer cette image d’immatérialité pour y inscrire l’idée de corrosion, d’un trop plein de la matière. Il s’établit ainsi quelque chose de manichéen dans l’opposition radicale entre le ciel qui est une absence et la matière qui est une corruption. L’acide attaque de manière insolente et péremptoire le velouté du métal, il produit une tache, une imperfection de la matière qui se manifeste d’emblée comme soumise à la prolifération. Les tableaux rouillés produisent ainsi le sentiment d’une disparition lente et inexorable. Au lieu de solliciter l’imaginaire de l’éternité de l’art, ils se donnent comme objets fictifs à la représentation fantomale. Dicrola joue avec l’éphémère et l’aléatoire, mettant en scène un sentiment de finitude, de corrosion, d’autodestruction et de mort qui va bien au-delà de la fragilité de la cire d’un Medardo Rosso ou de la précarité des papiers collés d’un Picasso. Ses premiers tableaux rouillés de 1989, comme Cheminée d’usine et Sortie de fumée, reprennent en plan serré la silhouette phallique des anciennes cheminées d’usine déjà célébrées par De Chirico comme symboles des temps modernes. Il en fait un motif unique qu’il cadre au plus près sur la verticale, ou encore sur l’horizontale lorsqu’il veut inclure la traînée de fumée s’échappant de la bouche de la cheminée. Son travail semble s’établir parfois en parallèle avec l’Arte Povera. À cette même époque, Kounellis traite en effet du thème de la cheminée, selon des procédés formels fort différents mais en rendant, lui aussi, hommage à De Chirico.
Dicrola y ajoute néanmoins une dimension évolutive puisque son dessin à l’acide introduit dans l’œuvre un processus de rouille qui va poursuivre son action au fil du temps, rongeant peu à peu la surface métallique recouverte de peinture industrielle. Cette mutation, produite à la manière d’un virus inoculé qui progresse lentement au sein d’un organisme, crée des effets d’oxydation, d’irisation cuivrée, de corrosion qui permettent à l’œuvre de se présenter comme une matière vivante, en perpétuelle réorganisation lente, le dessin se défaisant et se reconstituant sans cesse autrement. Dicrola prend en somme à contre-pied la célèbre observation de Léonard de Vinci. Il ne s’agit pas ici de dé- chiffrer une tache casuelle sur un mur en lui donnant une signification iconique. Son approche traduit au contraire une image de la réalité dans une tache volontairement causée par une altération chimique de la matière.
En 1989, dans son stand personnel présenté par la galerie Lacourière-Frélaut, à la foire d’Art contemporain de Gand en Belgique, Dicrola organise une salle en installant à même le sol, devant l’un de ses polyptiques intitulés Urbi mon amour, la mise en espace de l’œuvre. Il dispose un tas de charbons amoncelés au pied même du mur d’accroche afin de visualiser le processus de combustion nécessaire à l’énergie que suppose toute cheminée d’usine en tant qu’élément contextuel du paysage industriel. La critique relève, lors de cette exposition, que l’artiste se fait l’écho du jeu casuel des forces dont parle Schopenhauer. Ses cheminées sont en effet perçues comme une image pessimiste de la ville industrielle ou apparaissent comme une mise en dérision de sa valeur référentielle : la peinture de De Chirico. On y voit également la métaphore de la pollution qui règne dans la société du capitalisme industriel. Dicrola ferait ainsi une œuvre de dénonciation qui est en même temps une indication de la fragilité et de la fugacité de la culture, cette dernière pouvant être assimilée au panache qui s’échappe de ses cheminées. Parler de la fin de la culture revient à dire que la culture part en fumée.
Pendant la période 1990-1992, en développant ce nouveau cycle, Dicrola multiplie les solutions formelles, s’autorisant à explorer et à combiner toutes les possibilités expressives. Ses « tableaux rouillés » adoptent un format très allongé qui fonctionne de manière itérative par rapport à la silhouette verticale de la cheminée elle-même. Il introduit par la suite d’autres éléments du paysage industriel, comme dans Pylône haute tension où il ne symbolise plus la combustion qui produit l’énergie mais la circulation de celle-ci à travers des réseaux. Dans Chimneys, souvenir d’un séjour en Angleterre, il en arrive à renverser le format vertical en un format horizontal se composant de quatre panneaux juxta- posés qui découpent verticalement le nuage de fumée. Dissociant l’image de la surface matérielle de l’œuvre, il joue avec ironie de l’ancien procédé des estampes japonaises: l’image court sur plusieurs panneaux assemblés, se voulant autonome du champ du support, alors qu’en fait elle est physiquement ancrée dans sa matière.
Une variation de ce procédé est mise en œuvre dans le triptyque Cheminées nocturnes, où il utilise trois panneaux à fond noir, clin d’œil au traditionnel fond noir, réfléchissant et indéterminé des laques japonaises. Sur celui de gauche, une cheminée apparaît grâce au travail de la rouille. Au centre, alors que la peinture du panneau se révèle craquelée, il a simplement dessiné au trait une silhouette de cheminée. Le troisième panneau est vide. Le panache de fumée traverse les trois compartiments du triptyque, changeant de densité selon les panneaux. L’extrême matérialité de l’œuvre se trouve ainsi contredite par la valeur purement mentale de ses signes. Avec Minéraux, il opère une sorte de mise en abyme de la progression de la rouille. Il fait en effet apparaître un second motif de cheminée dans le nuage de rouille sortant d’une autre cheminée. Les panaches, semblables à des chevelures de femmes, défient toutes les lois d’expansion de la matière gazeuse. Le titre du tableau provient d’un raccourci. Le charbon, un minéral, brûle et devient fumée. Cette dernière apparaît ainsi comme la vie après la mort du minéral.
Une fois maîtrisé ce nouveau langage, son style devient plus dépouillé. Dans le triptyque Urbi mon amour, on assiste à un assombrissement scandé du support qui correspond pourtant à l’avancée de la fumée. L’icône n’est que signe tan- dis que le support mime la progression dans l’espace et dans le temps. Autrement dit, l’image s’inscrit en continu dans un support qui ne l’est pas. Ce jeu avec la structure, laquelle est fragmentée tout en étant traversée par une seule scène, rappelle les œuvres typiques des périodes de transition de l’histoire de l’art lorsqu’il y a disjonction entre une nécessité d’expression iconique et une résistance du support qui con- serve ses anciennes formes. Dicrola exalte cette dissociation afin de créer de nouveaux effets de distanciation de l’œuvre, obtenant des résultats d’une grande élégance formelle. Dans un tableau comme La cheminée et son fantôme, il joue sur le profil très évanescent de la cheminée répétée au centre de l’image. Il introduit la perception du devenir à la fois par les champs chromatiques des quatre panneaux et par cette silhouette à peine dessinée qui semble restituer la mémoire de la cheminée plutôt que la cheminée elle-même. Il crée un effet sériel par le support qui s’obscurcit en se déployant sur la droite alors que l’image rouillée établit une très forte opposition entre verticalité et horizontalité.
Dans d’autres cas, tel Cheminée et pylône, les panneaux s’articulent de façon séparée, chacun contenant sa propre image. Par ailleurs, ils semblent avoir été intervertis dans leur succession, ce qui donne un effet de mentalisation de l’image qui conteste l’impact de sa forte matérialité. Il s’agit d’un procédé qui renvoie également aux constructions narratives propres à la bande dessinée. D’autres toiles adoptent des constructions équivalentes. La composition en puzzle du tableau détruit encore plus la cohérence de l’image tout en provoquant un effet d’étrangeté qui participe à la distanciation inhérente au travail de la mémoire.
Parfois, il y a variation du support, ainsi une œuvre bipartite, tout en présentant la seule et unique image d’une cheminée fumante, associe un panneau en métal peint, gris vert et uni, à une tôle orange perforée. Dans Cheminée ionique, le profil de la cheminée est assimilé, en un clin d’œil ironique, à une sorte de colonne grecque alors que le panache de fumée qui en sort prend l’allure d’une plume. Le champ du tableau résulte de l’assemblage asymétrique de deux panneaux, celui de droite étant un objet trouvé: un plan métallique perforé de trous agencés en ligne, de couleur moutarde, tels ceux qui sont utilisés comme base d’accroche pour le rangement des outils. Mettant en évidence l’idée de panneau, Dicrola casse la cohérence de l’œuvre de façon à démystifier la prétendue naturalité de l’image. L’effet dissonant provoqué par l’incohérence du support se retrouve dans Pylône foudroyant, où il revient au thème des pylônes métalliques soutenant des lignes à hautes tensions. Il utilise dans ce tableau un matériau récupéré, c’est-à-dire un élément d’armoire électrique qui comporte une signalé- tique industrielle pour prévenir du danger d’électrocution. Il s’agit de l’un des rares exemples, dans sa production, où l’unité de l’œuvre semble remise en cause par la présence d’un élément hétérogène. Ce dernier ne survient pourtant pas par le biais d’un collage, technique qui est toujours ab- sente dans son travail, car son approche de la matière participe d’une tout autre sensibilité. En effet, sa conception de la matière est hantée par l’organique et le périssable, plutôt que par le fonctionnel mécanique ou le structurel agencé. C’est pourquoi l’axe de sa recherche demeure lié aux thèmes de la métamorphose, du changement, de la progression ou de la dissolution au sein de l’être. Il veut ainsi mettre en scène les processus et les temps de transmutation de la matière, provoquer la rencontre entre le concret et le mental pour montrer que toute chose est le résultat d’une élaboration alchimique qui ne connaîtra jamais de fin. Durant cette période, Dicrola se produit également dans plusieurs performances. La plus retentissante est Nuits polaires, consacrée à «son univers personnel», qu’il présente au DRAC-Centre d’Art Contemporain de Baillargue, près de Montpellier, en juin 1991. Il fait installer sur la scène des barres de glace empilées, six lourdes boîtes en plomb fixées sur le mur du fond à 80 cm du sol et une échelle en fer sous laquelle une comédienne dort nue, telle Eve dans le jardin d’Eden. L’espace est plongé dans une lumière tamisée et envahi par une vapeur continue. Accompagné d’une musique bruitiste de type «sidéral», Dicrola entre en scène un chalumeau à la main, habillé d’un scaphandre métallique, à la manière d’un astronaute. Il troue alors avec la flamme de son chalumeau les panneaux des boîtes en plomb, libérant ainsi des rayons de lumière qui frappent la femme nue et la réveillent. Il poursuit son action en perforant les autres boîtes, dont les fins rayons de lumière évoquent le dessin d’une constellation, puis en faisant fondre les blocs de glace avant de se déshabiller, lui-même, entièrement. Cette per- formance marque l’apparition du thème du rayon de lumière comme métaphore de fécondation ou de régénération que l’on retrouvera plus tard dans son œuvre.
Le Ministère de la Culture lui accorde l’année sui- vante un atelier tandis qu’il travaille principalement avec la galerie Varart à Florence, le Framart Studio à Naples, la Berner Galerie à Berlin, la Luckman Fine Arts Gallery à Los Angeles, les galeries Area et Henry Bussière Art’s à Pa- ris. Le répertoire iconographique de ses tableaux rouillés se diversifie, mêlant des thèmes occasionnels à ses thèmes obsessionnels. Dans Trace, où le mot « art » se présente comme une pancarte lapidaire, il utilise le même procédé d’oxydation sur métal peint, mais en renversant les valeurs. Le mot apparaît presque intact, en positif, au milieu d’une rouille qui a envahi tout le champ de l’image. Dicrola joue ainsi de la notion très classique, en peinture, de toile en réserve. L’art appartiendrait à la « réserve de la toile », résistant ainsi à une corrosion généralisée qui pourtant l’assiège de très près. Le tableau met en somme en scène la confrontation ultime entre l’art et le travail du temps. Il peint également des images d’enclumes ou d’organes isolés, telle une grande oreille solitaire au milieu du tableau dans Je vois par là de 1992, ou encore des objets métaphoriques, tels des appareils orthopédiques, des pièces mécaniques ou des instruments de cuisine. Ainsi, l’année suivante, dans Douche froide pour Atala, il rend hommage à Chateaubriand et à son conte philosophique sur un monde non contaminé par la culture urbaine et industrielle. En grand format, Dicrola réalise également unNouvel habit pour Atala, représentant un mannequin de couture que l’on retrouvera plus tard dans la série des « tableaux glacés ». Par ailleurs, ce tableau introduit un autre élément nouveau: la rouille ne se contente plus de former une silhouette linéaire dessinée mais engendre des effets de plasticité et de volume.
De façon semblable, dans d’autres tableaux de 1993, la rouille ne sert pas seulement à silhouetter l’objet mais à le rendre dans sa forme plastique, signe d’une maîtrise pleinement atteinte dans le contrôle du processus d’oxydation. Ainsi, Humain, trop humain, sous un titre qui se réfère ironiquement à Nietzsche, montre en grand format un muscle cardiaque mis à nu comme dans les tableaux de De Chirico. Mais ici l’organe est isolé et la toile est de si grand format qu’elle produit l’effet d’un grossissement péremptoire. La même année, cette œuvre est exposée à la Fiac, dans le stand de la galerie Thorigny, où Dicrola crée une installation proche, dans son style, de l’Arte Povera. Faisant allusion au rythme du muscle cardiaque, il place devant le tableau un pupitre avec partition. Durant l’été 1995, lors de l’exposition Répétition générale qui se tient à Barcelone, il est chargé par la mai- rie et par l’Institut culturel français de réaliser une action spectaculaire: éclairer des couleurs du drapeau français les trois hautes cheminées d’usine qui surplombent l’aire portuaire de la ville. Le projet, développé dans tous ses détails, est finalement abandonné après s’être révélé trop coûteux. De retour à Paris, Dicrola tire de cette expérience Les trois grâces de Barcelone, où la verticalité fortement affirmée des cheminées s’inscrit en contrepoint de l’horizontalité tout autant affirmée des panaches de fumée. Ce tableau ouvre une nouvelle série d’œuvres consacrées au thème iconographique de la cheminée industrielle.
Par ailleurs, sa recherche se poursuit en syntonie avec tout un pan de l’art moderne et contemporain. L’image réitérée du haut d’une cheminée d’usine, impliquant l’apparition d’un paysage industriel désert, renvoie en effet à la peinture métaphysique de De Chirico, mais aussi à l’Arte Povera de Kounellis et au cinéma d’Antonioni. Depuis la fin du XIXe siècle, l’usine elle-même apparaissait comme une imago templi de la modernité. Silhouette hiératique et solennelle, elle est en même temps l’un des monuments des temps modernes, exprimant même leur dimension presque spirituelle puisque la pointe d’une cheminée d’usine était comparée à la flèche d’une cathédrale. Après le milieu du XXe siècle, ce symbole s’est paré d’une composante mélancolique, devenant peu à peu l’image allégorique d’une civilisation destinée à disparaître. Le monde industriel commence alors à céder le pas au monde de l’informatique. La cheminée d’usine incarne ainsi une civilisation du fer qui meurt, elle n’exprime plus que la mémoire et le poids du passé.
Dans les tableaux de Dicrola, l’usine n’est jamais montrée, c’est toujours sa haute cheminée, sa flèche en tant que partie spirituelle, qui est figurée. L’artiste joue la métonymie, il représente la partie pour le tout, misant en outre sur l’ambiguïté du nuage de fumée qui est à la fois la part immatérielle et la part polluante de la production industrielle. Cette ambivalence se reflète dans une inversion entre les valeurs positives et négatives. Réaliser une belle tache de rouille afin de représenter une belle tache de fumée est aussi le moyen de racheter la laideur du monde industriel par la beauté de l’art. Le cycle des «tableaux rouillés» se conclut à la fin des an- nées quatre-vingt-dix, Dicrola portant alors à son paroxysme la qualité esthétique de ses images. Dans le tableau Fournaise, il propose à nouveau, au premier plan, la pointe d’une cheminée d’usine. Si la masse de briques de la cheminée est à peine dessinée, le panache de fumée, rendu avec la technique habituelle de la surface rouillée, acquiert une densité exceptionnelle. En arrière plan, le fond se constitue d’un champ uni sur lequel apparaît en surimpression la page de la rubrique « culture » du quotidien Libération, où se trouve un article sur les achats du Louvre accompagné de la tête d’une statue classique proche du David de Michel-Ange. Cette œuvre inaugure le recours au montage et à la promiscuité dans son travail. L’opération d’assemblage ne s’accomplit pourtant pas en fonction des valeurs tactiles et plastiques des matériaux, mais plutôt en fonction du contenu iconographique. De plus, cette image sera reprise plus tard dans la série des « tableaux glacés », incorporant alors le montage dans un ensemble qui procèdera de nouveau de la transmutation organique et unitaire.
Le thème du fer et de la civilisation industrielle se répercutera les années suivantes dans quelques œuvres faisant partie des « tableaux glacés » ou encore des « scanachromes». Poursuivant le passage continuel d’une technique à l’autre, Dicrola reprendra à plusieurs reprises le thème de la cheminée d’usine dans ses nouveaux tableaux. En 2002, par exemple, il réalise Culture, une de ses œuvres qu’il décline ensuite en version glacée et en version toile émulsionnée. L’image montre un fragment de la page dédiée à la culture dans le journal Libération, avec une chronique sur le Festival de Cannes, et le fragment d’un tableau de De La Tour. À la même époque, il crée également la version « tableau glacé » de Fournaise où perdure l’image de la cheminée industrielle.
En 2005, l’année où est commémoré le centenaire de la mort de Jules Verne, Dicrola achète De la terre à la lune chez un bouquiniste des bords de Seine. Il s’agit d’une édition très rare de 1929, publiée par Brodard & Taupin pour la libraire Hachette, avec des dessins à l’encre noire d’André Galland. Ce dernier, l’un des grands illustrateurs de romans- feuilletons de la première moitié du XXe siècle, a travaillé pour L’Illustration, Le Petit Journal, Le Journal, Le Matin. Il a surtout marqué l’imaginaire populaire avec des gravures réalisées pourSans Famille, Vidocq et Rocambole. Dicrola découvre avec surprise dans l’une des pages illustrées une encre noire représentant un paysage industriel sous-titrée d’une phrase de Jules Verne: «d’innombrables cheminées vomissent leurs torrents de fumée ». Il en tire aussitôt l’œuvre intitulée Jules, conçue comme un hommage au romancier visionnaire et à son illustrateur. Cette rencontre entre un grand écrivain populaire du XIXe siècle, un illustrateur de roman- feuilleton de la première moitié du XXe siècle et l’œuvre de Dicrola confirme que ce travail sur les cheminées d’usine s’inscrit dans une filiation qui participe de toute la culture de la modernité. L’hommage à l’époque industrielle, perçue à la fois comme un fantasme de puissance, mais aussi de crasse et de pollution, est dès son origine un élément romanesque très populaire. Le travail de Dicrola témoigne ainsi de cet échange continu entre le culturel et l’infra culturel dont parlait Antonio Gramsci. En effet, tout le travail créateur des avant- gardes se tient entre high & low, en tant que symbiose continue des thèmes iconographiques, des procédés expressifs, des stratégies communicationnelles, entre culture du progrès et culture sociale.
La cohérence d’une même recherche traverse ainsi les différentes phases du travail de Dicrola. Dans ces tableaux rouillés, la corrosion du support assure la pérennité d’un processus qui se traduit par une constante évolution de l’image. Destinée à se dématérialiser, celle-ci ne peut que devenir trace et mémoire. Sa disparition même est fantasmée, n’accordant à l’œuvre qu’une vie en sursis. Dès que la rouille a attaqué les surfaces métalliques, les images de Dicrola apparaissent à la fois précaires et ambiguës, saisies entre une traduction matiériste et une transcription men- tale de la forme idéelle qui a été à l’origine de l’œuvre. Le rapport de son travail à l’art conceptuel tient dans l’expérience cognitive qu’il met en œuvre. Autrement dit, dans cette disjonction qu’il opère entre la dimension physique du tableau, ainsi rendu à son statut d’objet réel, et sa dimension mentale en tant qu’acte de connaissance.
Écrit par Giovanni Lista.